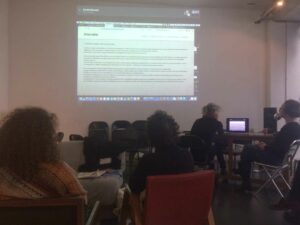FAIRE-ET-PENSER-ENSEMBLE
Rencontres
Du 5 au 10 novembre 2018
Marseille
Il s’agit d’investir les possibles rôles du cinéma, objets filmiques ou cinéma élargi, dans la création de lieux de et à « faire-et-penser-ensemble », des lieux d’accueil de l’hétérogène, de l’ailleurs et du loin, des lieux d’hospitalité et de convivialité, d’échanges et non d’appropriations. Comment le collectif peut-il se nourrir de l’ailleurs et se re-configurer en interaction avec lui ? Comment travailler le collectif, d’une manière non autoritaire, tout en maintenant la possibilité d’une autonomie créatrice ? « Le Collectif » selon Jean Oury, psychiatre et psychanalyste, fondateur de la Clinique de La Borde, s’entend non comme soumission au groupe mais comme dispositif permettant de voir émerger les singularités quelconques, singularités de toute sorte. Faire place à l’expérience avec, et voir émerger, peut-être, des cinémas-expériences qui n’imposent pas une seule idée-forme de cinéma.
Ces rencontres prolongent une première étape de recherche initiée dans chaque site du Réseau sur les notions de collectif, communs, et plus particulièrement concernant certaines pratiques artistiques, d’écritures poétique et/ou politique, qu’elles s’appellent collaboratives ou de co-création.
Ces rencontres « Faire-et-penser-ensemble » ont pour objectif de mettre en commun ces recherches, expériences, films (le collectif féministe Vidéo Out, un documentaire sur les mouvements de lutte et d’autogestion ouvrières au XIX au XXe siècle,…), puis de les étayer par un cycle de conférences de philosophe, historiennes et théoriciennes de l’art, afin de poser les bases de différents axes interrogeant et inventant des formes collaboratives pour des communs.
Lors de ces rencontres les étudiant.e.s se sont regroupé.e.s librement pour partager une question, une expérience qu’elle soit pratique ou théorique : créer une performance synchrone sur plusieurs sites, filmer ensemble des espaces urbains de Marseille en réaction avec l’actualité, créer une arborescence des termes utilisés pendant la semaine, engager une discussion sur la collapsologie, interroger la place des étudiant.e.s au sein des écoles d’art dans un contexte du discours de professionnalisation…
CONFÉRENCES
Les conférences ont eu lieu à La compagnie, lieu de création et au Festival International de Cinéma FID Marseille.
Joëlle Zask, → L’expérience de l’art, ou du collectif au commun.
Philosophe, spécialiste de philosophie politique, du pragmatisme et de John Dewey, maître de conférences, Joëlle Zask s’est beaucoup intéressée aux formes de la démocratie et de la participation. Elle a publié « Participer : Essai sur les formes démocratiques de la participation », 2011 ainsi que de « Art et démocratie », Paris, Presses universitaires de France, 2003. Elle partage avec nous ses réflexions sur les formes participatives et l’art.
Aline Caillet, Dispositifs critiques.
Maître de Conférences en esthétique et philosophie de l’art à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne (Institut ACTE -UMR CNRS 8218, équipe Æsthetica). Ses recherches portent sur l’inscription de l’art dans la réalité sociale et politique et visent à redéfinir sa fonction critique dans l’art contemporain. À travers un parcours croisé entre théories esthétiques et pratiques artistiques contemporaines (art-action, performances, arts visuels et cinéma), elle construit une esthétique pragmatiste du fait critique qui privilégie sa dimension contextuelle et réinscrit l’art comme praxis à visée émancipatrice. Dans sa conférence elle évoque plus particulièrement de nouvelles formes de documentaires en arts visuels et leur conceptualisation en tant que dispositifs critiques.
Véronique Goudinoux, → Pratiques artistiques de co-création : enjeux contemporains.
Ancienne pensionnaire de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis), historienne et théoricienne de l’art contemporain, Véronique Goudinoux est professeure à l’université de Lille.
Membre du laboratoire Centre d’étude des arts contemporains (CEAC), elle co-dirige avec Véronique Perruchon et Séverine Bridoux-Michel le programme de recherche « Collaborations entre artistes » et a édité pour la revue électronique du CEAC « déméter » un numéro thématique sur les pratiques de co-création. Elle a publié l’ouvrage « Œuvrer à plusieurs. Regroupements et collaborations entre artistes » (Presses du Septentrion, 2013, 237 p.), première synthèse en France sur le sujet, et dirigé avec Florian Gaité et Catherine Henkinet, le livre « Collaboration et co-création entre artistes. De 1960 à nos jours » (éditions Canopé, 2018).
Ecrire autrement l’histoire, penser la globalisation, donner une place et une visibilité aux artistes femmes ou aux artistes des minorités, etc. : tels sont quelques-uns des enjeux que l’on peut repérer lorsque l’on étudie les nouvelles pratiques et formes artistiques collaboratives ou de co-création. Son intervention se propose de montrer comment les artistes œuvrant en groupe, en duo ou en collectif, contribuent aujourd’hui de manière singulière aux grands débats du monde contemporain.
Jean-Pierre Rehm, One, two, many.
Écrivain-critique cinématographique, délégué général du FIDMarseille depuis 2002. Jean-Pierre Rehm a su soutenir en France « des cinémas » toujours à la frontière entre les champs, se nourrissant de transversalités multiples, devant ainsi un passeur traducteur important des oeuvres cinématographiques pour lesquelles le FID est un pays à part entière.
Il nous partage son expérience de programmation au festival, ses rencontres avec les jeunes cinéastes à travers le monde et l’énergie sensible de ceux.celles-ci. Il présente une sélection de films relié par le motif musical et issus des sélections du FID Marseille : Peter Friedl, King kong (2001) ; Anri Sala Long Sorrow (2005) ; Manon de Boer, One, two, many (2012)
VISITES
Rencontres avec l’équipe du cinéma et vidéoclub → Vidéodrome 2 pour échanger sur la construction d’un lieu de diffusion alternatif.
OUTILS NUMÉRIQUES
Une présentation et discussion par Skype avec Axelle Rossini, webmaster du site web du Réseau Cinéma.
Après la décision prise en 2018 de créer une plateforme numérique pour partager nos recherches, nous avons contacté pour la réalisation de ce site une jeune artiste connaissant le Réseau Cinéma depuis ses débuts en 2015 pour y avoir participées.
L’objet de cette rencontre via Skype était de présenter l’avancée de la construction de l’arborescence et des choix graphiques pour que les étudiant·e·s lui indiquent ce qu’il·elle·s attendaient de ce site en termes d’identification du projet et comme outil de partage.
DOCUMENTATION
En partenariat avec
Conférences disponibles en ligne
+ d’informations sur les invité·e·s
Bibliographie
- Bibliographie du Réseau cinéma
- « Œuvrer à plusieurs : enjeux d'aujourd'hui », Demeter Revue électronique du centre d’Étude des Arts Contemporains, Université Lille 3, 2019
- Collectif, "Du commun au comme-un", Revue Multitudes, n°45, 2011
- Jean Oury,Le collectif (Le séminaire de Sainte-Anne), 2005, éd. Champ social
- Irit Rogoff, turning, e-flux Journal #00 - November 2008
- Joëlle Zask, « Art et démocratie sont-ils antinomiques ? », in L'Observatoire, 2012/2, n° 41, pp.51-56