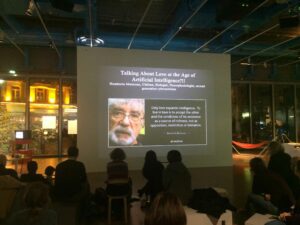ESADTPM TOULON
Enseignants : Serge Le Squer
À partir des questions soulevées pendant le workshop initial intitulé →Qu’est-ce qu’un espace blanc ? Figure de l’absent. le Réseau à l’ésadtpm se structure autour d’un axe principal de recherche complété par des études annexes, dans une perspective postcoloniale amenant à la fois à penser les lieux de l’art comme hétérogènes au-delà d’une conception humaniste universelle euro-centrée et les lieux d’une « politique du semblable » et d’un « en-commun », tels que les définit A. Mbembe.
« (…) tant que l’on continue de faire croire que l’esclavage et le colonialisme furent de grands faits de « civilisation », alors la thématique de la réparation continuera d’être mobilisée par les victimes historiques de l’expansion et de la brutalité européennes dans le monde. Dans ce contexte, une double démarche est nécessaire. D’un côté, il faut sortir de tout statut victimaire. De l’autre, il faut rompre avec la « bonne conscience » et le déni de responsabilité. (…) Il est vrai que le monde est d’abord une manière de relation à soi. Mais il n’y a guère de relation à soi qui ne passe par la relation à Autrui. Autrui, c’est à la fois la différence et le semblable réunis. Ce que nous devons imaginer, c’est une politique de l’humain qui est, fondamentalement, une politique du semblable, mais dans un contexte où, c’est vrai, ce que nous partageons d’emblée, ce sont les différences. Et ce sont elles qu’il nous faut, paradoxalement, mettre en commun. Ceci passe par la réparation, c’est-à-dire par un élargissement de notre conception de la justice et de la responsabilité.» MBEMBE Achille, Critique de la raison nègre[1]
Pour définir l’axe principal, comme les autres écoles du Réseau nous avons visité des musées locaux à la recherche d’éléments liés à l’histoire coloniale (Museum départemental du Var et Musée national de la Marine de Toulon). À la différence des autres écoles du Réseau ayant privilégiées des études sur des collections muséales, nous avons cherché à l’ésadtpm un lieu construit avec le projet colonial et son exploitation des ressources naturelles. La recherche de ce lieu au-delà de la question de la propriété d’un artefact colonial mais posant la question de l’appropriation, de l’exploitation et du bouleversement concomitant des écosystèmes, nous a amené à étudier les jardins exotiques dans leurs différentes fonctions au cours de leur histoire (octobre 2016 à mai 2018). Cet axe s’est ensuite prolongé par une recherche sur des lieux de non-appropriation en mettant en question et mettant en pratique la question du partage comme altérité (Jean Oury[2]) ou comme expérience du participable (Cornelius Castoriadis[3]) pour une « politique du semblable » (Achille Mbembe) (octobre 2019 à janvier 2020).
De manière complémentaire à cet axe principal de recherche, le Réseau à l’Ésadtpm s’est aussi intéressé à des études dans des espaces non-européens et particulièrement du pourtour méditerranéen : co-organisation par le réseau à l’Ésadtpm et Geneviève Houssay (Mucem) de la masterclass de la curatrice Rasha Salti sur le territoire de la Palestine comme espace de projection, d’effacement et de résistance par l’imaginaire (mars 2017, Mucem, Marseille) ; participation au symposium « Curating after the Global: Roadmaps for the Present » à l’invitation de Lotte Arndt du Réseau de Valence (septembre 2017, Luma, Arles) ; co-organisation par le réseau à l’Ésadtpm avec Bétonsalon du workshop « Eaux stagnantes » avec l’artiste Ali Cherri ouvert aux autres écoles du Réseau (décembre 2017, Bétonsalon, Paris) ; visite des expositions A Hard White Body de Candice Lin (décembre 2017, Bétonsalon, Paris) et Cosmopolis #1 (décembre 2017, Centre Pompidou, Paris) ; rencontre avec Zahia Rahmani commissaire de l’exposition Sismographie des luttes (décembre 2017, Inha, Paris) ; participation aux journées d’étude sur l’archive vidéo des mouvements sociaux au présent en Tunisie et Algérie comme élément structurant du Hirak (octobre 2019, Mucem, Marseille) ; participation aux journées d’étude sur l’exploration des diverses formes de stratégies féministes et LGBTQI+, de la sphère de l’intimité aux grandes questions de société en Turquie (décembre 2019, Mucem, Marseille).
Le détail des recherches de l’axe principal et des études complémentaires sont accessibles dans l’espace documentation de la page.
Les étudiant.e.s du groupe ont produit des objets filmiques, des dessins et animations, des pièces sonores, des essais de cartographie à partir de ces visites des jardins, des objets intégrant du végétal, des productions collaboratives, des productions avec des objets ou images d’une mémoire collective et des situations jouant du participable. Ces recherches ont été prolongées lors des rencontres et workshops de l’ensemble du Réseau Cinéma → Les temps collectifs, → Laboratoires d’Aubervilliers (mars 2017), → Grenoble (mai 2018), (novembre 2019). Certaines de ses formes produites ont été intégrées à leurs projets de diplômes de DNA ou DNSEP.
[1]MBEMBE Achille, Critique de la raison nègre, Paris : La découverte, 2013, p.254-255
[2]DEYRES Martine, Le Sous-bois des insensés, 89′, Les Films du Tambours de Soie et Centre Edgard Morin/IIACD – CNRS, 2015
[3]CASTORIADIS Cornelius, Les carrefours du Labyrinthe 1, Paris : Le seuil, 1978
DOCUMENTATION
Axes principaux de recherches
Études complémentaires
Co-organisation avec Geneviève Houssay (Mucem) de la masterclass de Rasha Salti, « Palestine : territoire, mémoire, projections » , La compagnie et Mucem, Marseille, mars 2017
Palestine, un territoire en images
Symposium « Curating after the Global: Roadmaps for the Present » , LUMA Arles
Visite de l’exposition Sismographie des luttes, INHA, Paris, décembre 2017
Bande- annonce de l’exposition
Archives de l’exposition
Journée d’étude
Journée d’étude