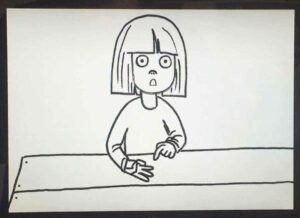FAIRE PLACE À L’EXPÉRIENCE AVEC (1e session)
Production
25-29 mars 2019
La compagnie, Marseille
Durant cette semaine à La compagnie, lieu de création (Marseille), les étudiant.e.s mettent en commun leurs pratiques, qu’elles soient plastiques ou théoriques développées depuis l’automne 2018. «Faire place à l’expérience avec» est une session de production organisée en autonomie par une partie des étudiant.e.s du Réseau Cinéma ayant souhaité y participer. Ce choix de l’autonomie s’inscrit directement dans le projet du Réseau Cinéma d’interroger et expérimenter les formes collectives, tant à partir de la notion de Collectif chez Jean Oury (1) que du concept d’autonomie opposée à l’hétéronomie chez Cornelius Castoriadis (2).
Après un accueil par des enseignant.e.s du Réseau Cinéma, les étudiant.e.s se sont réunis sans les en- seignants pour présenter à chacun leur production en cours ou « parler » la recherche qu’il.elle.s sou- haitent mettre en commun durant cette semaine, puis ont décidé, de manière autonome, l’agencement du calendrier de la semaine : les moments de mise en commun entre étudiant.e.s, et ceux auxquels étaient invités les enseignant.e.s. Les discussions et conférences de la session de novembre 2018 ainsi que les rencontres avec les collectifs d’artistes en janvier 2018, les ont aidé.e.s à imaginer leur autonomie à partir de leurs besoins (3) et particulièrerment de co-construire leur recherche singulière, collective ou non, avec l’aide du regard des autres. Durant la semaine, plusieurs axes ont été esquissés : un film collectif à partir de rushes filmés à Aix-en-Provence, à Bruxelles lors des rencontres du Réseau en janvier puis à Marseille durant la semaine ; confection d’un écran brodé dans la trame du tissus de motifs liés à des souvenirs ; ré- alisation une animation pour un centre de documentation sur la maltraitance et les abus sexuels sur enfant ; mise en mouvement d’une image d’archive d’un orphelinat fondé en Arménie soviétique après le génocide arménien par projection sur un tissu provenant de la ville où se situait cette institution ; décomposition nu- mérique de photographies de cartes postales de la Martinique des années 1910-1920 ; production de films à partir de l’activation d’un jeu construit avec l’arborescence des termes employés durant les rencontres du Réseau en novembre ; réalisation d’un film à partir d’une archive de vidéosurveillance de particuliers, d’ad- ministrations ou d’entreprises.
A la fin de la semaine, une discussion collégiale entre les étudiant.e.s et des enseignant.e.s du Réseau a tenté de réfléchir sur l’expérience de cette semaine en autonomie, en la reliant avec les autres sessions du
Réseau, afin d’en extraire des observations pour co-construire cet agencement de communs et de diffé- rences qu’est le Réseau Cinéma.
(1) « Pindare disait (…) « Partage est leur maître à tous » (…) partage ne veut pas dire partager, mais tenir compte de la spécificité. (…) le singulier, c’est la place de tout un chacun, qui n’est jamais la même qu’un autre. Alors pour faire admettre ça …, ça peut sembler subversif, « comment ? t’es contre l ‘égalité ? t’es contre la justice ? ». Non, je suis pour l’hétérogène (…), même s’il fait semblant d’être comme un autre, c’est pas vrai (…). Ça se partage ça, il n’y en a pas un pareil qu’un autre. » Jean Oury in DEYRES Martine, Le Sous-bois des insensés, 89’, Les Films du Tambours de Soie et Centre Edgard Morin/IIACD – CNRS, 2015
(2) « Partager c’est donner en excluant. (…) Mais il existe certainement des choses sociales qui sont en tant qu’elles sont participables et non partageables : langues, coutumes, … L’« appropriation » de la langue par un individu non seulement n’exclut pas mais implique son « appropriation » par d’autres individus en nombre indéfini. De même : l’« acquisition » par un individu de la vertu ne rend pas plus difficile, mais plus facile son « acquisition » par les autres.
Le participable est ce qui ne peut pas être partagé. (…) la justice totale est précisément cela : création du participable social et des conditions, voies, moyens, assurant à chacun l’accès à ce participable; et séparation du participable et du partageable.» Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe 1, Paris, Éditions du Seuil, 1978 (réédition 1998), pp. 365-366
(3) Lors de la discussion de bilan suite à la rencontres du Réseau avec des collectifs d’artistes à Bruxelles, un étudiant avait noté qu’à l’origine des collectifs il y avait la nécessité, ou le désir, de mettre des outils ou recherches en commun.
DOCUMENTATION
En partenariat avec
Bibliographie