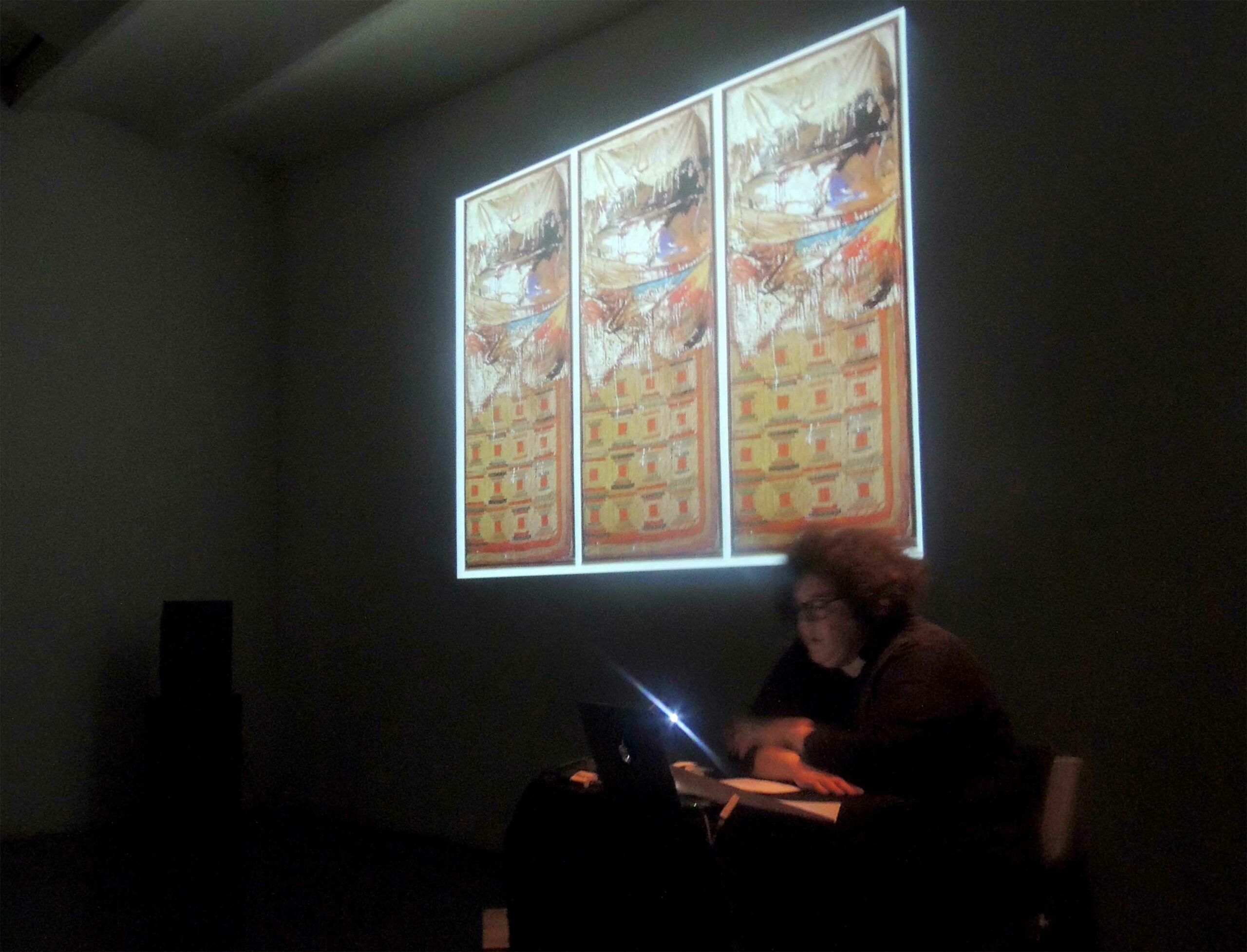QU'EST-CE QU'UN ESPACE BLANC ? FIGURE DE L'ABSENT.
Production collective du Réseau de recherche cinéma / Conférences.
14-18 mars 2016
La compagnie, Marseille
Les écoles supérieures d’art d’Aix-en-Provence, de Tours Angers-Le Mans (site d’Angers), Toulon Provence Méditerranée, de Valence-Grenoble et de Bourges ont invité Zahia Rahmani et Habiba Djahnine à organiser une Masterclass-workshop intitulée « Qu’est ce qu’un espace blanc ? figure de l’absent. », dont l’objectif était à la fois pratique et théorique.
Il s’est déroulé à La Compagnie, lieu de création contemporaine situé dans le quartier de Belsunce à Marseille, en relation avec l’exposition au Mucem intitulée Made in Algeria, généalogie d’un territoire dont Zahia Rahmani (écrivaine, théoricienne et historienne de l’art), en collaboration avec Jean-Yves Sarazin (directeur des Cartes et plans à la BNF), était la commissaire.
Habiba Djahnine, réalisatrice du film Lettre à ma sœur (2006), et fondatrice du festival Béjaïa Doc, invite les jeunes réalisateurs Djamil Beloucif et Hassen Ferhani pour nous donner un éclairage sur la situation du cinéma indépendant contemporain en Algérie tant au niveau de la production ( → Inland, de Tariq Teguia, 2008 ; → Exterminator de Abdelghani Raoui, 2016 ; Hysteresis de Tahar Kessi, 2011; Rani Miyet (Je suis mort) de Yacine Benelhadj, 2014 ; Dans ma tête, un rond-point d’Hassen Ferhani, 2015) qu’en ce qui concerne les nouvelles formes alternatives d’enseignement du cinéma en Algérie et particulièrement aux Ateliers du Béjaïa Doc.
Todd Shepard, chercheur à la Johns Hopkins University de Baltimore, spécialiste de la France contemporaine et des études post-coloniales en France et Algérie, en résidence à l’Iméra (Université Aix-Marseille), nous à rejoint pour la soirée introductive de la Masterclass.
Lors de cette semaine de Masterclass en duo avec Zahia Rahmani et Habiba Djahnine ont eu lieu plusieurs moments de projections, une visite de l’exposition au Mucem, des conférences et discussions, des repas communs et productions collaboratives entre les 35 étudiant·e·s et les enseignant·e·s.
L’espace blanc est abordé à la fois par le biais du trauma et de la mémoire impossible : une mémoire fragmentaire compilée par des dispositifs collectifs de partage qui permettent à une parole et à des images de se configurer. Habiba Djahnine décrit le cheminement effectué pour récolter la parole à partir de la relation de l’audible à l’inaudible : « Qu’est ce que je puis dire qui soit audible, face au refus d’entendre, comment le dire autrement ».
La visite de l’exposition au Mucem, Made in Algeria, est la première exposition d’envergure consacrée à la représentation du territoire algérien. Made in Algeria montre comment l’invention cartographique a accompagné la conquête de l’Algérie et sa description. L’exposition réunit un ensemble de cartes, dessins, peintures, photographies, films et documents historiques d’une qualité rare. Sont aussi présentes dans l’exposition et en contrechamp de cette production européenne, des œuvres inédites d’artistes contemporain·e·s qui ont arpenté le territoire algérien. Loin de reproduire un espace préexistant, le parcours de l’exposition met en exergue la relation dialectique par laquelle carte et territoire se constituent réciproquement. Le territoire algérien se configure à travers les représentations cartographiques, à la fois produits et fondements de la conquête coloniale. “Dans la langue de l’Empire, il n’y a qu’une langue, celle de l’Empire” (Edward Saïd).
Jean-Pierre Rehm, directeur général du FIDMarseille, nous présente une sélection de films en relation avec le titre de la Masterclass « Qu’est ce qu’un espace blanc ? figure de l’absent. ». Il énonce la proposition que l’espace blanc du workshop est porté par une idée de justice. Cette position est importante, mais il précise qu’il est également nécessaire de ne pas trop rapidement remplacer l’absent par une présence. Pour rendre justice, il faut laisser arriver pleinement l’absence. Il remet en question la fonction miroir du cinéma en prenant l’exemple du film de Jean Rouch et Edgar Morin, Chronique d’un été (1961). Partant du constat qu’une absence qui n’est pas complètement présente est fantomatique, il conseille aux étudiant·e·s plusieurs films : Jacques Tourneur, Vaudou (I walked with a zombie) (1943) ; Dreyer, Vampyr ou l’étrange aventure de David Gray (1932) ; Nobuhiro Suwa, H story (2001) ; James Whale, L’homme invisible (1933) ; Rithy Panh, S21 La machine de mort khmère rouge (2004) ; Guy Debord, Hurlement en faveur de Sade (1952) ; Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, Ici et ailleurs (1970-76); Sven Augustijnen, Spectres (2011). Puis il nous commente et fait voir les films de Pierre Huygue, Blanche neige Lucie (1997) ; Pere Portabella, Mudanza (2008) et Elise Florenty, Le soulèvement commence en promenade (2011).
Parmi les questions abordées lors des discussions collectives de la Masterclass-workshop :
– qu’est ce qu’un espace blanc (le silence, l’absent, le recouvrement, la lumière, l’ouverture, la surexposition, la conquête)
– la dimension cartographique de l’espace blanc sur les cartes et ses multiples fonctions (recouvrement, ignorance, disqualifcation, effacement….),
– la dimension sonore (bruit blanc, bruit rose…..),
– la dimension raciale ou racisée (renvoi vers les Critical Whiteness Studies et notamment le livre de Richard Dyer « White », et de Maxime Cervulle « Dans le blanc des yeux »….),
– la dimension cinématographique (le blanc comme espace de projection, l’écran, révéler et couvrir, la dialectique des lumières, sous-exposition/sur-exposition, voir les travaux d’Ismail Bahri, et de Bruno Boudjelal),
– le blanc comme couleur et comme absence de couleur. L’absence qui renvoie vers une impossibilité, vers une nécessité, vers une présence en creux… L’absence et le minoritaire ; une nécessité d’inscription ou de reconnaissance là où il y a un manque, une béance, un besoin.
– comment ne pas reproduire la violence en la montrant, mais la transformer en récit ;
– des stratégies documentaires qui permettent de rendre audible ce qui est silencieux, endroit fragile où les choses prennent forme ;
– de la nécessité de sortir des binarismes sécurisants (les uns et les autres, les bons et les mauvais….) des stéréotypes, projections, fantasmes et orientalisme notamment quand on traite des configurations complexes des sociétés coloniales et postcoloniales.
– quels liens personnels avec l’Algérie
– l’espace comme espace à jouer, espace à partager, un espace commun, un territoire imaginaire, une science fiction
– quelles circulations des corps et des marchandises au-delà des frontières, diaspora, échanges et rencontres ; la langue, la traduction, l’hybridité, l’hétérolinguisme.
Pour accompagner les questions soulevées depuis le début de la semaine, Zahia Rahmani donne sa conférence L’indienne déroulée dans le cinéma de John Ford, ou les chemins d’un malentendu. « Blanket Head » (Tête de couverture) est l’invective qu’adresse à plusieurs reprises Ethan Edwards (John Wayne) à Martin Pawley (Jeffrey Hunter) dans le film The Searchers (La Prisonnière du désert) de John Ford (1956). Qu’est-ce donc que cette invective ? D’où vient qu’une tête puisse être une couverture ? À partir d’exemples ethnographiques, artistiques et autobiographiques, Zahia Rahmani présente le récit d’un recouvrement du corps, convoquant des images d’Edward Curtis à Robert Rauschenberg, en passant par une certaine représentation photographique de la figure féminine en temps de guerre. La conférence établit les liens entre les productions de Rauschenberg dans les États-Unis des années 1950, la photographie documentaire d’un Walker Evans, de James Agee et Edward Curtis, une scène de La prisonnière du désert de John Ford et les tapisseries cherokee. À la croisée de ces œuvres et documents s’esquisse une relecture d’œuvres aujourd’hui canonisées de l’histoire de l’art, qui promet de surmonter leur compréhension exclusivement formaliste.
Habiba Djahnine présente son travail au sein des Rencontres du film documentaire à Béjaïa qu’elle crée en 2003, et de l’école de documentaire Béjaïa-doc qu’elle crée en 2007. Elle projette le film → J’ai habité l’absence deux fois de Drifa Mezenner, réalisé par une participante du Béjaïa Doc en 2011. Ensuite Habiba Djahnine décrit la méthode de travail au sein des ateliers du Béjaïa-Doc, de la phase d’écriture au tournage puis au montage mêlant apports théoriques, pratiques et présentation orale des pistes de travail en image. La formation s’effectue durant plusieurs rendez-vous collectifs étalés sur une année. Puis elle décrit comment l’équipe des formateur·rice·s du Béjaïa-Doc constitue les groupes à partir d’un appel à candidature. L’un des axes de la pédagogie est d’aider les participant·e·s aux ateliers à préciser d’où il·elle·s parlent, avant de partir filmer : « Pourquoi je veux absolument ce film, d’où je parle et pourquoi c’est moi qui dois faire ce film ». Dans la discussion, se pose la question de l’espace à partager comme un espace de construction au-delà de sa propre biographie. Comment créer un espace commun entre filmeur et sujet filmé et permettre au sujet filmé de se réapproprier le dispositif de la prise de vue. En 2013, Habiba Djahnine arrête les ateliers du Béjaïa-Doc pour se concentrer sur la création d’une formation de cinéma en 2 années qui prendront le nom d’Atelier de création de films documentaires et auxquels participeront en 2018, deux étudiantes présentes à cette Masterclass- workshop à Marseille.
Elle se termine sur une journée de discussion entre les étudiant·e·s, Habiba Djahnine, Zahia Rahmani et les enseignant·e·s autour des projets en cours des étudiant·e·s. Plusieurs projets ont commencé à prendre forme, et s’inscrivent dans des recherches à moyen ou long terme. Les étudiant·e·s présentent oralement les recherches effectuées en s’aidant de la projection de photographies et d’extraits vidéos ou de la diffusion d’extraits sonores.
Un premier bilan est effectué avec les étudiant·e·s pour émettre des propositions et suggestions pour les prochaines rencontres du Réseau.
PROLONGEMENTS
ADANDÉ Joseph, → Les Toiles appliquées ou tentures
DERRIDA Jacques, Le monolinguisme de l’autre, Paris : Galilée, 1996
DJAHNINE Habiba, « Identification par le « je » et territorialité fragile du cinéma en Algérie », in Nouvelle Revue Synergies Canada, 2013, n°6 → https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc/issue/view/176
DYER Richard, « La Lumière du Monde : photographie, cinéma et blanchité », in Revue Poli – Politique de l’Image, Juin 2015, n°10 (Techno-racismes). → https://polirevue.wordpress.com/anciens-numeros/numero-10/
HARAWAY Donna, « Savoirs situées, question de la science dans le féminisme et privilège de la perspective partielle » in Le manifeste cyborg et autres essais. Sciences – Fictions – Féminismes, Paris : Exils, 2007
MBEMBE Achille, « Afrofuturisme et devenir-nègre du monde » in Politique africaine, Paris, Karthala, 2014, n°136, pp.121-133.→ https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2014-4-page-121.htm
MBOM Clément, Edouard Glissant, De l’opacité à la relation
NGUGI Wa Thiongo, Décoloniser l’esprit, Paris, La Fabrique, 2011,
RAHMANI Zahia, Jean-Yves SARAZIN (dir), Made in Algeria, généalogie d’un territoire, Marseille : MuCEM, Vanves : Hazan, 2016, 239 p
SPIVAK Gayatri, Les subalternes peuvent-elles parler ? Paris, Éditions Amsterdam, 2009
SAÏD Edward, L’orientalisme, l’orient créé par l’occident, Paris : Seuil, 2005.
YACINE Kateb Yacine (interview), Un certain regard (Ina) → https://www.youtube.com/watch?v=9nUNqOXLomc
YACINE Tassadit, « Femmes et espace poétique dans le monde berbère », CLIO Femmes, Genre, Histoire, 1999, n°9 → https://journals.openedition.org/clio/287#bodyftn5
DOCUMENTATION
En partenariat avec
+ d’informations sur les invité·e·s
+ d’informations sur l’exposition Made in Algeria
Visite virtuelle de l’exposition Made in Algeria
Masterclass – Workshop